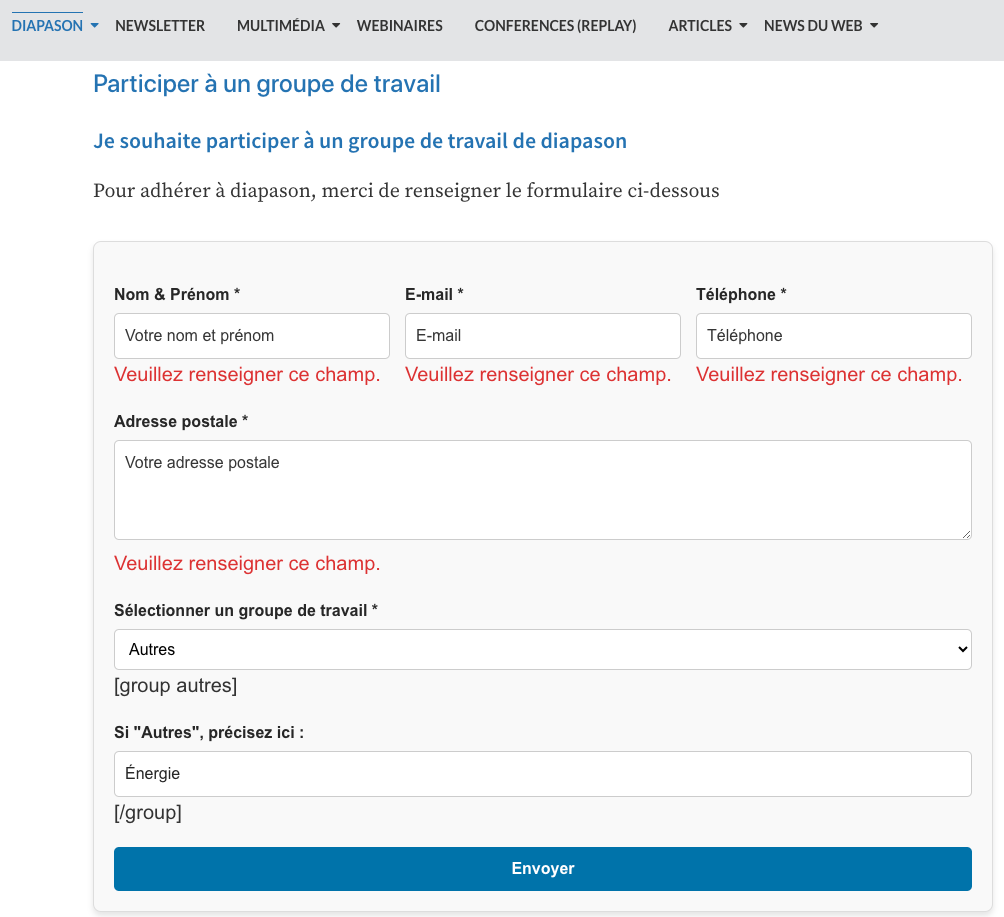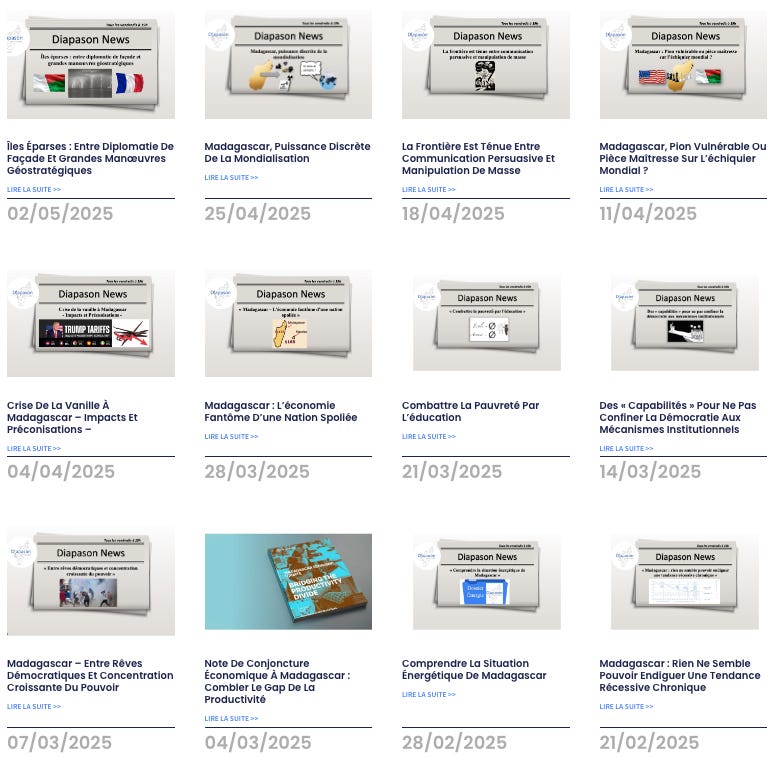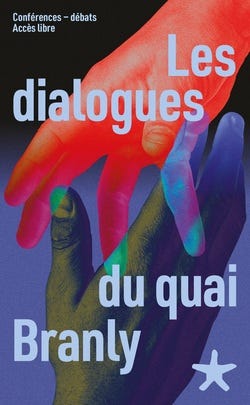Madagascar : Souveraine ou sous-traitante ?
Comment un pays peut-il prétendre à la souveraineté si tous ses leviers sont actionnés de l’extérieur ?
En savoir plus sur cette lettre : À propos
Bienvenue aux nouveaux lecteurs et merci aux autres pour leur fidélité.
🎙De quoi allons-nous parler ?
Au sommaire de cette 14e édition :
- Édito
- Actus Diapason
- Podcast
- Books
- Bon à savoir (thématiques, abonnés, abonnement)
Édito
Diapason s’est intéressé ce mois-ci à l’OHADA - Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (https://www.ohada.com) - et plus particulièrement aux enjeux d’une adhésion éventuelle de Madagascar qui a fait l’objet d’un colloque, le 29 avril dernier, à l’Université Panthéon-Assas. C’était à l’occasion de la sortie d’un ouvrage collectif intitulé « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit - Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui aborde diverses questions de droit des affaires, dans le contexte d'un rapprochement souhaité, notamment par les opérateurs économiques, entre l'OHADA et Madagascar.
Outil juridique créé, en 1993 (traité de Port-Louis) pour servir l’intégration et la croissance, l’OHADA regroupe aujourd'hui 17 États et compte à son actif dix actes « uniformes » (actes pris pour l'adoption de règles commune à tous les États-parties au traité) déjà entrés en vigueur dans les États membres. Diapason compte relayer le plaidoyer en faveur de cette adhésion dont la pertinence devrait réunir sinon l’unanimité, au moins une confortable majorité.
Madagascar revendique sa souveraineté, mais ses lois, son économie et même sa parole publique restent fragiles. Qu’il s’agisse de l’exploitation minière, du droit des affaires ou de la mémoire collective, une même question revient :
Peut-on vraiment faire Nation sans un socle juridique commun et une volonté collective d’émancipation ?
Ce n’est pas un détail technique, c’est un acte politique : dire que nous ne voulons plus vivre dans l’arbitraire.
Accepter des règles communes, c’est accepter de bâtir sur du solide.
Tour d’horizon des 4 derniers articles de Diapason
1. Des ressources contrôlées par d'autres
L’affaire des îles Éparses illustre un cas d’école : sous couvert d’écologie ou de cogestion, la France verrouille un espace maritime stratégique sans réelle concertation. La biodiversité devient argument de façade, pendant que 700 millions de tonnes de pétrole transitent chaque année par le canal du Mozambique.
Dans le sous-sol, même logique : nickel, cobalt, ilménite et graphite alimentent la transition énergétique mondiale, mais les contrats restent opaques, les revenus minimes et les impacts locaux lourds.
Article : Îles éparses : entre diplomatie de façade et grandes manœuvres géostratégiques
2. Une économie mondialisée mais fragmentée
Plus de 90 marques de mode produisent à Madagascar. Les centres d’appels gèrent les clients de grandes banques européennes. Le pays fait partie du top 10 africain du BPO. Et pourtant, les flux de richesses fuient vers les holdings offshore, pendant que les ouvriers sont payés 2 € par jour.
Les zones franches, censées stimuler l’économie, sont devenues des enclaves hors sol, sans ruissellement ni transformation locale. Madagascar produit, mais ne décide pas.
Article : Madagascar, puissance discrète de la mondialisation
3. Une opinion publique manipulée
Dans un pays où l’éducation reste un défi majeur, où la précarité rend les esprits vulnérables, les élites politiques utilisent des méthodes de manipulation de masse pour détourner l’attention.
Des figures d’autorité, des discours simplistes, un usage ciblé des émotions et des médias : tout est mis en œuvre pour entretenir la confusion et éviter le débat réel sur la souveraineté.
Article : La frontière est ténue entre communication persuasive et manipulation de masse
4. Madagascar, pion vulnérable ou pièce maîtresse ?
Face à l’exploitation de ses ressources via des circuits offshore, Madagascar peut transformer sa vulnérabilité économique en levier stratégique si elle ose une diplomatie économique audacieuse.
Article : Madagascar, pion vulnérable ou pièce maîtresse sur l’échiquier mondial ?
Sens commun aux 4 sujets concernant Madagascar
Madagascar est au cœur de nombreux enjeux géopolitiques et économiques mondiaux, mais reste marginalisé dans la répartition des richesses et des décisions, notamment à cause d’un déficit de souveraineté, de lucidité stratégique et de mobilisation collective.
Ce pays est riche. Pas seulement en ressources naturelles ou en main-d’œuvre qualifiée, mais en potentiel stratégique global. Pourtant, cette richesse est exploitée ailleurs, au profit d’intérêts qui savent jouer de ses failles : fiscalité permissive, élites ambivalentes, opinion manipulable. Les îles Éparses, la fiscalité offshore, les chaînes textiles mondialisées, ou encore les stratégies de communication politique ne sont pas des sujets séparés. Ils racontent une même histoire : celle d’une souveraineté nominale, vidée de sa substance.
Reprendre le contrôle ne signifie pas tout nationaliser ou rompre avec le monde. Cela signifie comprendre les règles du jeu mondial, en identifier les angles morts, et oser formuler ses propres règles. Cela signifie aussi éduquer, mobiliser, et dénoncer les simulacres de coopération qui perpétuent la dépendance.
Il est temps que Madagascar cesse d’être la pièce que l’on déplace sur l’échiquier, et devienne celle qui déplace les autres.
Diapason se définit comme un think tank indépendant, généraliste et non partisan, dont la vocation est de poser les bonnes questions, nourrir le débat et stimuler l’intelligence collective à Madagascar. La question de la souveraineté réelle - qu’elle soit économique, médiatique ou symbolique - est au cœur de cette mission.
En soulevant cette question centrale, Diapason ne cherche pas à désigner des coupables, mais à rendre visibles les logiques invisibles, à armer intellectuellement les citoyens, et à créer un espace où l’exigence remplace la résignation.
Tant que les Malgaches ne connaîtront pas la valeur de ce qu’ils produisent, de ce qu’ils savent faire, de ce que leur géographie leur donne, la souveraineté restera un mot vide.
Le combat n’est pas militaire : il est intellectuel, économique, diplomatique.
Saurons-nous passer de la dénonciation à l’action ? De la dépendance à la négociation ?
“Le pays continue de brader son potentiel, alors même que l’économie mondiale dépend de sa production.”
- Diapason, avril 2025
Les Actus Diapason
Webinaire
Le deuxième webinaire Diapason a porté, le 23 avril, sur le thème « Faire Nation (Espérer) » et a vu la participation de Patrick Rakotomalala, entrepreneur social (Diapason, Zama, Isika, Fact…), Mantchini Traoré, experte en ingénierie culturelle (Cultur’Elles, L’instant Thé), et Toavina Ralambomahay, politologue et écrivain, vice-président du conseil municipal d’Antananarivo. Il fait suite à la conférence organisée, le 15 octobre 2024, par le groupe de travail Faire Nation.
L’idée de « Faire Nation » apparaît comme un défi quasi insurmontable pour les Malgaches qui se sentent trahis par la politique et la corruption. Malgré tout, il y a une minorité d’acteurs (entrepreneurs, penseurs, sociétés civiles, associations, religieux, artisans, étudiants, etc…) qui investissent dans ce pays au futur incertain.
Nous avons échangé sur la possibilité, voire la nécessité, de reconstruire une nation unie malgré les obstacles du passé et le désespoir du présent.
Prochain Webinaire de mai 2025 : Restitution de l’enquête Ainga & Ako
Avec :
Groupes de travail
Vous pouvez, désormais, vous inscrire à des groupes de travail et/ou proposer un nouveau groupe de travail, via le site web de Diapason :
Les groupes de travail en cours
- Éducation
- Faire Nation
- Contrat social
- Énergie
- L’agriculture / La paysannerie
Les productions du Comité de rédaction :
📰 1 article par semaine - Vendredi à 19h - 🕖
Les articles à venir :
Cartographie économique des communautés
Une Afrique si proche et si lointaine pour les Malgaches
Sortie d’un livre (disponible en pré-commande sur le site de Diapason)
Écrit par Roger Rabetafika, Alain Rasendra, Patrick Rakotomalala (3 protagonistes de Diapason) et leurs comparses (les 2 anonymes de M/car-Tribune, Ndimby A. et Patrick A), ce livre est préfacé par le Pr Raymond Ranjeva.
🎙Podcast
Voici le podcast de Mai 2025
Accédez à tous nos podcasts audios & vidéos avec les liens ci-dessous :
. Plateforme : https://smartlink.ausha.co/diapason-madagascar-think-tank
. Émissions : https://podcast.ausha.co/diapason-madagascar-think-tank
. YouTube : https://www.youtube.com/@diapasonmada/podcasts
Bon à savoir
« Afrique-France, au-delà du ressentiment »
Le jeudi 3 avril 2025 dernier, le musée du quai Branly – Jacques Chirac a accueilli une conférence intitulée « Afrique-France, au-delà du ressentiment », dans le cadre de son cycle « Les dialogues du quai Branly » dont nous vous invitons à consulter le programme.
Cet événement s'est tenu au Théâtre Claude Lévi-Strauss et a été animé par Julie Gacon, journaliste à France Culture.
L'invité principal était Elgas (El Hadj Souleymane Gassama), sociologue, journaliste et écrivain franco-sénégalais. La discussion s'est centrée sur son essai Les Bons ressentiments : Essai sur le malaise post-colonial, publié en mars 2023.
Dans cet ouvrage, Elgas examine les tensions identitaires et les conflits intellectuels entre l'Afrique et la France, remettant en question certaines approches décoloniales contemporaines et appelant à une lecture plus nuancée de l'histoire commune.
Par son positionnement, elle exonère de tout et s’invite sur le “champ finalement commode, où personne n’est responsable, sinon la colonisation" et l’esclavage.”
« Il s’avère pour l’essentiel, que les indépendances n’ont pas apporté les ruptures attendues mais ont plutôt comprimé les espérances, obligeant beaucoup d’enfants d’Afrique à rêver d’un ailleurs plus clément. »
Cette citation illustre la volonté d'Elgas de dépasser les postures victimaires pour encourager une prise de responsabilité et une réappropriation active de l'histoire et de l'identité africaines.
L'événement a attiré un public varié, notamment des chercheurs, des étudiants et des passionnés de débats sur les relations post-coloniales.
Pour plus d'informations sur cet événement, vous pouvez consulter la page officielle du musée : Afrique-France, au-delà du ressentiment